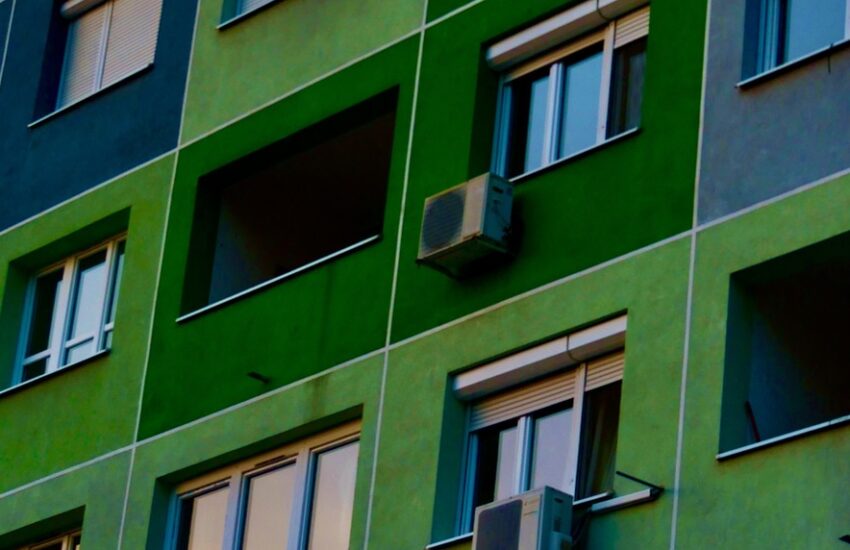Le théâtre indépendant de Budapest joue sa survie
La culture n’échappe pas à la mainmise du gouvernement de Viktor Orbán, qui assèche financièrement la scène indépendante hongroise. Si le pessimisme domine chez les artistes, des îlots de résistance subsistent.
Dans un flot d’applaudissements, les comédiens s’inclinent sous les projecteurs de l’UP Rendezvénytér, au nord de Budapest. Béla Pintér est l’un des metteurs en scène les plus en vue du théâtre indépendant : impossible de rater sa pièce Vérvörös Törtfehér Méregzöld (Rouge sang Blanc cassé Vert poison). Même sans saisir une bribe de magyar.
Attablée devant une Soproni fraîche, une bière locale, Leonetta L. accepte de dérouler un à un les actes de la pièce. La jeune comédienne amatrice, férue de stand-up et de théâtre, fait défiler des portraits sur son téléphone. Une représentante du gouvernement chargée de la lutte contre le Covid-19, un membre haut placé du Fidesz… et surtout le Premier ministre du même parti nationaliste, Viktor Orbán. Car chaque comédien incarne, sur les planches, un personnage réel.

des comédiens arborent des masques traditionnels Busó, de la minorité croate Šokci. Photo : Csaba Mészáros.
En allumant une cigarette, Leonetta raconte comment les failles de la société hongroise sont étirées, moquées, questionnées. Une guerre en vue avec la Russie ? Elle est évitée par une combine. Les personnages s’inquiètent de la « pureté » de l’identité hongroise ? Ils clament leur origine rom, dans un retournement de la discrimination visant cette minorité. Viktor Orbán, joué par Béla Pintér, fait les frais d’une trame fantasque, où son homophobie le rend sourd au messager, ouvertement homosexuel (jusqu’au cliché), qui lui apporte pourtant la clef du drame. Empêtré dans l’infamie – il découvre qu’il a épousé sa propre fille – le personnage d’Orbán manque de se tirer une balle de revolver dans la tempe. Pour sûr, le chantre des « valeurs chrétiennes » de l’Europe aurait peu apprécié le spectacle.
Main-basse sur la culture
Dans un pays où les voix dissidentes sont étouffées, cette hardiesse créative étonne. D’autant que Viktor Orbán entend mettre la culture au pas. Dès son élection en 2010, il place sous la coupe du Ministère des Ressources Humaines (EMMI) le Fonds National pour la Culture (NKA), alors indépendant. La même année, l’Académie Hongroise des Arts (MMA), pourtant privée, se voit priée de « faciliter la prévalence et la protection des valeurs de la culture hongroise » et « le respect des traditions des arts hongrois ». Nouveau coup de massue en 2018, lorsque les théâtres sont exclus d’un financement par l’impôt des entreprises (TAO), puis en 2019, avec l’accaparement des fonds publics par le Conseil National de la Culture. Obtenir des subventions est une gageure : les appels d’offres sibyllins, enrobés de tournures nationalistes, sont peu en phase avec l’art libre.
Parallèlement, des proches du Fidesz sont nommés à la tête d’institutions culturelles prestigieuses. Parmi eux, l’inévitable metteur en scène Attila Vidnyánszky, ami de Viktor Orbán, qui empoche en 2013 la direction du Théâtre National de Budapest, puis en 2020 celle de la célèbre Université des Arts du Théâtre et du Cinéma (SZFE), malgré la mobilisation des étudiants. Nombre d’entre eux rejoignent alors l’Université d’Europe Centrale délocalisée à Vienne, en Autriche, quand d’autres créent la Free SZFE, une contre-Université, en dehors du système Orbán.
Pas de censure, mais l’asphyxie financière
« On ne peut exister que rejetés à la marge », affirme Dóra Büki, cofondatrice de la compagnie Proton, avec le metteur en scène et réalisateur primé à Cannes Kornél Mundruczó. Entre les murs de bureaux sans âme, au centre de Budapest, la productrice dépeint avec une colère froide la lente asphyxie du théâtre libre. En cinq ans, Proton est passé de 60.000€ de subventions annuelles au néant. La pandémie de Covid-19 a fini de grever son budget, dépendant pour moitié de partenariats internationaux. « Il n’y a pas de dialogue, nous n’avons aucune réponse à nos questions », regrette-t-elle. La lassitude pointe : « Je ne sais pas combien de temps je pourrai tenir ». Un profond pessimisme, aussi : « Ce que vous voyez à Budapest, ce sont les restes de la scène indépendante. Je ne recommanderais à personne de s’y lancer. Je n’y vois aucun avenir »
On ne peut exister que rejetés à la marge. Ce que vous voyez à Budapest, ce sont les restes de la scène indépendante.
Dóra Büki, productrice et cofondatrice de la compagnie Proton
Pourtant, la capitale fourmille de théâtres populaires. L’Átrium, le Szkéné, le MU… Et l’incontournable Trafó, dans le huitième arrondissement, où défile depuis 1998 la crème de la danse, du théâtre, de la musique et des arts visuels de Hongrie. Son fondateur György Szabó arpente, songeur, l’ancien transformateur électrique mué en temple de la libre expression, où se pressent chaque année 45.000 spectateurs. Un voile assombrit son regard : « Notre but, c’était l’innovation, cette liberté qui donne tant de bonheur. Mais ce n’est plus possible ». Le manque d’argent, toujours. « Nous sommes en faillite. La guerre [de la Russie contre l’Ukraine] a éclaté, et nous dépendions d’une banque russe [la Sberbank, cible des sanctions européennes], déroule-t-il. En douze ans, les subventions ont diminué de moitié. Avec l’inflation, la perte est immense. »

György Szabó s’arrête dans la grande salle de 300 places, où une poignée de danseurs finalisent leur mise en scène avant la répétition générale. L’ancien pensionnaire de l’ex-Université Karl Marx de Budapest soupire : « C’est parce que je suis économiste que je suis pessimiste. Il faut vendre toujours plus de tickets, produire en flux tendu ». Avec des gestes lents, où s’entremêlent douceur et abattement, le chorégraphe fustige la quête permanente de rentabilité, néfaste à la créativité. Qu’en est-il alors de Béla Pintér, qui fait salle comble chaque soir ? « C’est du mainstream indépendant, rétorque György Szabó. Un art plein de clichés, devenu du divertissement. » Dans un sourire triste, il s’excuse de sa remarque : « Je ne lui en veux pas, il faut bien gagner sa vie. »
Des bouts de ficelle et des brins d’espoir
De l’autre côté du Danube, on tente de raviver l’espérance. Au nord de la colline surplombée par le Bastion des Pêcheurs, l’association Indépendants Ensemble (FÜGE) a reconverti en 2006 une ancienne école en centre artistique. Derrière chaque porte de l’immense bâtiment de la Maison Jurányi (Jurányi Ház), dont la mairie de centre-gauche finance 80% du loyer, une salle de classe réaménagée en bureau, en espace de répétition ou de représentation. On y joue dans des pièces nues, néons éteints au plafond, deux ou trois projecteurs et de petites enceintes pour le bruitage. Bien loin du faste du Théâtre National ou de l’Opéra, plus de 40 compagnies s’y produisent. Dans les couloirs, on croise des associatifs lancés au secours d’artistes perdus entre les dossiers administratifs et la quête de financements.
« La solidarité entre danseurs, comédiens, dramaturges, photographes… C’est ça l’esprit ici, sourit Judit Böröcz, metteuse en scène employée par FÜGE. L’auto-organisation pallie, en partie, l’abandon de l’État. « On a une blague entre nous, lâche-t-elle dans un joli rire. Quand on voit un nouveau projet modelé pour le pouvoir, on se dit : “oh, il y a un nouveau Festival de la Saucisse ! » Elle tient à préciser : « c’est bien que ces événements existent. Mais la création indépendante est abandonnée. Pour autant, nous ne sommes plus dans les années 1950, nous n’avons pas à être terrifiés par la censure. »

Sillonnant l’ancienne école, Judit Böröcz pointe des affiches aux murs : « cette pièce moque le nationalisme, celle-ci la promotion d’une écrivaine médiocre par le Fidesz ». Elle-même a mis en scène un spectacle passant l’identité hongroise au crible de l’ethnographie. « Le gouvernement fait croire que nos racines et notre histoire sont figées et éternelles, ce qui n’a aucun sens, détaille-t-elle. Mais je pense qu’ils sont avant tout pragmatiques. C’est une façon de renforcer leur pouvoir ». L’art peut-il alors le faire vaciller ? « Je ne sais pas si on peut changer les choses, tempère-t-elle. Ici, ou à Trafó, nous restons dans une bulle. Nous sommes entre nous, nous nous parlons à nous-mêmes. En Hongrie, on évoque peu la politique en famille, on évite d’anciens amis passés « de l’autre côté » ».
La création indépendante est abandonnée.
Judit Böröcz, metteuse en scène
Mais nous ne sommes plus dans les années 1950,
nous n’avons pas à être terrifiés par la censure.
Rêves de jeunesse
Tout l’enjeu est de pousser les murs, d’élargir son public. En pariant sur la jeunesse, déjà. Dans les cartons, un projet avec des lycéens, sur leur rapport à la nation lors des commémorations de la révolution hongroise de 1848, le 15 mars. Et déjà sur les rails, le programme Titánium qui, fort de six éditions, offre un tremplin à une dizaine de jeunes artistes. « Pendant quatre mois, ils travaillent avec des dramaturges, des comédiens, des techniciens, et nous les assistons à chaque étape », explique Dóra Gulyás, coordinatrice du projet. « J’ai l’impression d’être la maman des pièces qui sont montées, confie-t-elle. Je les accompagne de l’idée à la scène. Vu le contexte en Hongrie, ça fait du bien de voir l’espoir et l’ambition des jeunes. »
Parmi eux, le comédien Endre Papp, 29 ans. Le regard doux, sirotant un café dans la cour aérée de Jurányi, il pourrait parler des heures de sa pièce Góliakalifa, adaptée d’un roman de Mihály Babits (en français Calife-cigogne, In Fine éditions). Elle lui a valu le Titánium Award en 2016, couronnant la meilleure création de l’année. Six ans plus tard, il la joue encore. Seul en scène, il y incarne un riche sénateur vivant dans ses songes la vie d’un homme pauvre condamné à voler pour survivre. Au fil du temps, les rêves se font plus réalistes. Une lutte acharnée s’installe. L’homme bloqué dans les rêves veut s’arracher à la misère. L’éveillé, lui, étouffe de cette double existence, jusqu’à pousser l’intrus à mettre fin à ses jours. Le récit d’une cohabitation invivable, ou celui d’un passage impossible entre deux mondes.

«On s’est inspiré de documentaires sur une prison pour jeunes criminels qui, retrouvés par les cinéastes 40 ans plus tard, n’ont pas pu échapper à leur condition ». Une ombre passe sur le visage d’Endre Papp : «En Hongrie, le fossé entre les classes sociales est immense.» Les comédiens n’échappent pas à la règle. «Avec le Covid-19, beaucoup sont devenus livreurs, charpentiers ou ouvriers, glisse-t-il. J’ai la chance de travailler pour un Théâtre National [en province], j’ai conservé le salaire minimum [de 540€].» Son sourire se fait mélancolique. «Nous avons de l’imagination, mais sans argent nous ne pouvons pas nous permettre de rêver.» Ou alors, seulement rêver d’ailleurs. « Je pense à émigrer. Pourquoi pas Vienne ? La ville est riche culturellement, pleine de couleurs.» Son regard se perd au loin, vers d’autres rives, d’autres scènes, d’autres vies à jouer.